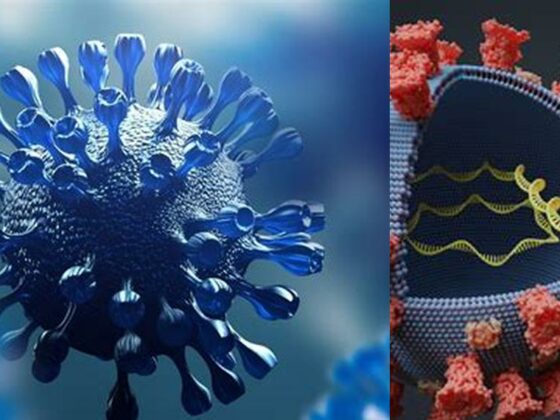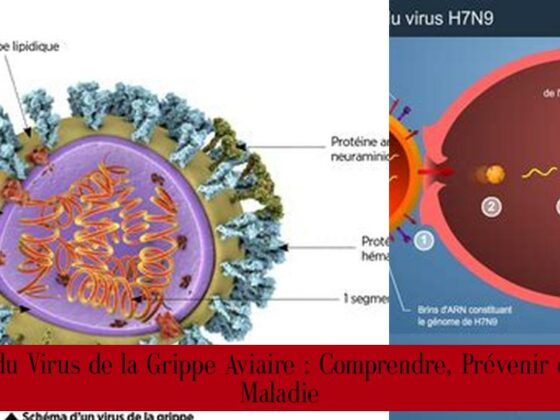Sommaire
- Quels sont les exemples typiques de ruminations qui peuvent survenir?
- C’est complètement contre-productif! Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il aussi mal?
- Le cerveau aurait donc naturellement tendance à réfléchir à ce qui peut aller mal?
- Qu’entendez-vous par « métacognitions»?
- Quelles conséquences ont ces croyances sur notre vie quotidienne?
- Pourquoi ne peut-on pas tout simplement dire à son cerveau d’arrêter de penser?
- Ce réseau cérébral se met à tourner en boucle?
- Quelle différence y a-t-il entre les ruminations qui se développent dans le cadre de la dépression et celles qui prennent racine dans l’anxiété?
- Peut-on tirer parti de ces connaissances pour briser le cercle des ruminations?
- Outre les interventions pharmacologiques, des approches plus spécifiquement cognitives peuvent-elles réduire les ruminations?
- Peut-on tout simplement se distraire en regardant un bon film?
- Et du côté des thérapies cognitivo-comportementales?
Qu’est-ce qui provoque les ruminations ? Nous en avons tous. Elles représentent un mode particulier de fonctionnement de notre cerveau quand il cherche une solution à un problème mais n’y parvient pas. Alors, il revient sur le problème, une deuxième fois, puis une troisième, et comme il n’arrive pas à trouver de solution, il commence à produire en plus des émotions négatives comme de l’angoisse ou du stress. De ce fait, la rumination n’est pas seulement un phénomène cognitif, c’est aussi un processus émotionnel. Et les émotions douloureuses vont engendrer d’autres ruminations.
Quels sont les exemples typiques de ruminations qui peuvent survenir?
Une rumination courante tourne autour du travail. Je suis surchargé, j’ai trop de choses à faire, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Je prends mon cas personnel: dans mon métier, je commence à me dire que j’ai des patients à rappeler, des articles en retard à envoyer, et c’est là que mon cerveau commence à faire tourner cette rengaine comme une tâche de fond sur un ordinateur.
C’est involontaire, mais cela continue à tourner en arrière-plan, comme un bruit de fond, consomme de l’énergie mentale, et finit par être épuisant.
Et surtout c’est inefficace car cela ne débouche pas sur de l’action, ne m’amène pas à organiser mon planning de façon efficiente en fonction de ces préoccupations, et il en résulte un sentiment de menace diffuse, comme une épée de Damoclès. Mais les ruminations concernent aussi la santé la sienne ou celle de ses proches des problèmes d’argent, des tensions relationnelles, de la souffrance au travail…
C’est complètement contre-productif! Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il aussi mal?
En fait, il ne fonctionne pas forcément si mal; il faut garder à l’esprit qu’il est fait pour nous préserver des dangers, et ce depuis des centaines de milliers d’années. Les humains, pendant 99,99% du temps qu’ils ont passé sur Terre, ont vécu dans un environnement où rôdaient les prédateurs.
On peut comprendre que, dans ce contexte, notre cerveau ne s’est pas constitué pour nous assurer de la détente ou de l’insouciance. Au contraire. Il s’est configuré comme une machine à détecter les dangers, et à les anticiper pour mieux survivre. C’est une machine à surveiller ce qui peut se passer mal.
Cet organe a évolué dans une logique d’adaptation à un environnement avec l’élaboration de stratégies qui permettent de se prémunir contre les menaces. C’est pourquoi il est sujet à des biais, qui ont persisté de nos jours : l’un d’entre eux est le biais de négativité ou de pessimisme.
Je vous donne un exemple: si vous êtes un Homo erectus parcourant la forêt il y a 2 millions d’années et que vous voyez un buisson bouger, est-ce que à vous avez intérêt à être pessimiste et à croire qu’il y a un prédateur derrière, ou à être insouciant et supposer que c’est la brise printanière qui fait remuer le feuillage ? Un individu qui est «biaisé» vers le pessimisme et présuppose la présence d’un danger pourra dire merci à son biais de pessimisme le jour où il y aura bien un prédateur derrière le buisson.
Il survivra, alors que son camarade insouciant sera éliminé du processus de l’évolution. Donc, à la limite, il vaut mieux avoir un cerveau équipé d’un biais qui surinterprète le danger que le contraire.
Le cerveau aurait donc naturellement tendance à réfléchir à ce qui peut aller mal?
Il a été sélectionné en partie d’après ce critère, et ce qui nous importe aujourd’hui, c’est de savoir comment ce biais se manifeste dans notre monde moderne. De nos jours, notre environnement s’est tellement complexifié que les êtres humains peuvent passer leur journée à sauter d’un danger potentiel à un autre.
La menace terroriste, l’insécurité au quotidien, la perte d’un emploi, le risque d’attraper un virus pandémique, le risque de se faire vacciner: on peut voir des risques partout. Mais le pire, ce sont les métacognitions que nous créons par-dessus ces biais.
Qu’entendez-vous par « métacognitions»?
Revenons à une situation concrète: je me dis que je n’ai pas fait tout mon travail, qu’un certain nombre de mes patients ne vont pas bien et que je n’ai pas encore pu leur redonner un rendez-vous. Je perçois cela comme un danger. Mon cerveau le détecte, et tourne en boucle autour. Mais cela résulte d’une métacognition : c’est ma croyance que si je surveille tout constamment, tout ira bien. Or cette croyance n’est pas forcément justifiée, ni consciente.
On le voit chez les personnes qui ont vécu un psychotraumatisme, un viol, une guerre. Leur cerveau est réglé sur un mode d’hypervigilance permanente, lié à une métacognition inconsciente selon laquelle le même danger peut revenir à tout instant et que la seule chance de survie consiste à être hyperattentif à tout signe annonçant sa possible venue.
La personne reste alors bloquée dans cette manière de fonctionner et surveille tout sans relâche.
Quelles conséquences ont ces croyances sur notre vie quotidienne?
De telles métacognitions sont en partie façonnées par nos expériences passées. Notre cerveau est certes une machine à prédire ce qui peut mal se passer, mais il le fait en fonction de ce qu’il a observé avant.
Là encore, ce processus a été sélectionné sur des centaines de milliers de générations pour remplir une fonction de survie: si un Homo erectus se promenait avec un ami près d’une grotte et qu’un ours surgissait et dévorait son camarade, son cerveau passerait en hypervigilance à la vue de la moindre grotte, anticipant le danger.
De nos jours, cela prend une forme un peu différente : vous venez d’accepter un nouveau travail, mais vous avez eu des expériences douloureuses dans votre précédent emploi. Dès lors, votre cerveau va prédire le fait qu’il faut faire attention, que l’environnement professionnel peut engendrer du rejet.
Or qui dit rejet, dit danger, là encore en vertu d’un très long processus de sélection : il y a 100 000 ans, être rejeté de son groupe équivalait à la mort, les chances de survie d’un individu isolé dans la jungle étant presque nulles.
Aujourd’hui, la personne rejetée de son travail ne meurt pas, mais garde toujours la même empreinte cérébrale de l’exclusion, qui a été visualisée en imagerie cérébrale. Tout cela fait que l’environnement de travail est très générateur de ruminations, le cerveau étant susceptible de passer en mode d’hypervigilance dans ce contexte.
LES RUMINATIONS SONT UN TOUR QUE NOUS JOUE NOTRE CERVEAU
Pourquoi ne peut-on pas tout simplement dire à son cerveau d’arrêter de penser?
Notre cerveau ne s’éteint jamais. On sait depuis maintenant une vingtaine d’années, grâce aux travaux du neuroscientifique américain Marcus Raichle, de la faculté de médecine de Saint Louis, dans le Missouri, que lorsque nous ne faisons rien, un réseau d’aires cérébrales s’active. On l’appelle le «réseau du mode par défaut».
Son rôle? Produire des pensées de toute sorte, mais évidemment lorsqu’on a des préoccupations ces pensées vont commencer à tourner autour de ces thématiques.
Conséquence: on va d’autant plus ruminer quand on n’a rien à faire (par exemple, quand on est allongé le soir dans son lit…) et qu’on a un certain nombre de tâches en suspens ou de problèmes non résolus à l’issue de sa journée, ou d’incertitudes sur l’avenir. Autre possibilité : lorsqu’on est dépressif. Les pensées négatives («je suis nul(le), je ne vais pas y arriver») commencent à absorber l’activité du réseau de mode par défaut, qui tourne en boucle autour de ces attracteurs mentaux.
Ce réseau cérébral se met à tourner en boucle?
Exactement. Dans ces situations, on voit que les connexions neuronales au sein du réseau de mode par défaut se modifient. À force d’emprunter les mêmes chemins, la pensée se fraie un sentier qui devient familier, plus facile à emprunter. C’est comme lorsque des skieurs s’élancent pour la première fois le matin sur les pistes quand il est tombé beaucoup de neige pendant la nuit: les premiers tracent une voie dans la neige profonde, puis les suivants ont tendance à emprunter les mêmes trajectoires car c’est plus facile. Il y a une vraie facilitation du cycle de rumination au fil des répétitions.
De ce fait, les réflexions des patients deviennent rigides et stéréotypées. Ces derniers expriment souvent les mêmes soucis avec les mêmes mots. Que ce soit dans le couple ou au travail, lorsque les personnes se sentent menacées, leur discours commence à emprunter toujours les mêmes structures et les mêmes mots…
A lire aussi : Dossier – Dites Stop aux pensées Négatives & Neuralink: que fait l’implant cérébral d’Elon Musk?
Quelle différence y a-t-il entre les ruminations qui se développent dans le cadre de la dépression et celles qui prennent racine dans l’anxiété?
Le réseau du mode par défaut, qui engendre nos pensées spontanées, est très important pour notre vie intérieure, car il nous permet à la fois de voyager dans le passé (en visitant nos souvenirs) et dans le futur (par
l’imagination). Chez un patient dépressif, c’est le voyage dans le passé qui prédomine. À mesure que ce réseau produit une activité stéréotypée, se développe un «enlisement nostalgique»; le patient passe son temps à comparer son présent misérable avec un passé où tout allait bien, ou alors à revenir vers un événement douloureux du passé qui pèse sur son présent.
Chez un sujet anxieux, c’est le voyage dans le futur qui se rigidifie: le réseau va ressasser des imaginaires négatifs et se connecter à des contenus émotionnels désagréables.
Peut-on tirer parti de ces connaissances pour briser le cercle des ruminations?
Modifier la connectivité neuronale constitue un vrai moyen d’action contre ce phénomène. Il existe plusieurs méthodes pour cela. Certaines agissent par voie pharmacologique, en utilisant des substances qui sont aujourd’hui de plus en plus étudiées, les psychédéliques. Ces molécules tirées de plantes ou de champignons induisent des modifications profondes dans la conscience et la cognition, en partie grâce à leur influence sur le réseau du mode par défaut.
Les recherches menées en ce domaine semblent indiquer que les psychédéliques comme la psilocybine (extraite d’un champignon) et le LSD (une molécule de synthèse), ont la capacité de réduire l’activité et la connectivité au sein du réseau de mode par défaut, ce qui pourrait expliquer que les patients décrivent un sentiment de «dissolution de l’ego», comme si leur soi se décomposait et que ses frontières avec le monde extérieur s’estompaient.
Cette diminution de l’activité du réseau de mode par défaut pourrait interrompre les schémas habituels de pensée et de rumination, permettant ainsi aux individus d’adopter des perspectives nouvelles sur ce qui leur arrive.
Écouter ou faire de la musique, se distraire en regardant un bon film, dessiner, ou même faire un peu de ménage peut suffire à focaliser l’attention sur une activité simple et gratifiante, et à réduire les ressassements.
En outre, les psychédéliques ont la capacité de promouvoir la plasticité neuronale et synaptique, en particulier dans le cortex préfrontal, ce qui pourrait aider à réinitialiser les réseaux cérébraux et amener des changements durables dans les modèles de pensée et le comportement.
Outre les interventions pharmacologiques, des approches plus spécifiquement cognitives peuvent-elles réduire les ruminations?
La méditation de pleine conscience donne de bons résultats. Le bénéfice est ici une remise en compte des croyances ou des métacognitions qui nous paralysent. Une pratique efficace de la pleine conscience va ainsi conduire le patient à se rendre compte qu’il a des croyances délétères (comme être persuadé que si on surveille tout en permanence, rien n’arrivera) et à relâcher leur emprise, de sorte qu’on se détache de l’envie de penser à un problème en boucle.
Mais, de façon générale, il existe une grande variété de stratégies susceptibles d’être mobilisées contre les ressassements, et certaines fonctionnent chez certains patients et non chez d’autres. Il faut se tester pour le savoir. Par exemple, une activité physique régulière produit chez de nombreuses personnes un effet antirumination dont les effets vont persister entre 24 et 48 heures. Si cela fonctionne, il s’agit il alors de répartir ses séances de sport en conséquence, à raison d’au moins trois fois par semaine.
L’exercice physique a un impact sur le cerveau, notamment en entraînant une baisse de perfusion sanguine du cortex préfrontal qui semble alléger l’action du réseau de mode par défaut, mais également la libération de facteurs de croissance neuronale qui stimulent la neuroplasticité ou la libération d’endorphines et de dopamine, génératrices de plaisir.
Au-delà de la pratique sportive, tout ce qui détourne l’attention du sujet de la rumination va avoir un effet positif. Si vous êtes angoissé à cause de votre travail, faire un peu de ménage peut suffire à focaliser votre attention sur une activité simple et éviter le retour en boucle des pensées négatives; tout comme écouter ou faire de la musique, dessiner, idéalement se consacrer à une activité qui procure le fameux état de flow (ou «flux», en français), où l’on se sent entièrement absorbé par ce qu’on fait, avec un sentiment d’autoefficacité dans l’activité pratiquée.
Peut-on tout simplement se distraire en regardant un bon film?
Effectivement, favoriser les émotions positives peut avoir un impact favorable sur les ruminations. Ainsi, on a observé que des volontaires récupéraient mieux des émotions négatives comme les ressassements et l’inquiétude après avoir été exposés à un film joyeux, par rapport à ceux à qui on a diffusé un film neutre ou triste ou qui n’ont été soumis à aucune intervention.
Induire des états émotionnels positifs pourrait donc être une stratégie efficace pour atténuer les ruminations. Les systèmes émotionnels de notre cerveau sont très connectés au réseau du mode par défaut, qui a tendance à tourner en boucle.
Et du côté des thérapies cognitivo-comportementales?
En la matière, l’approche de restructuration cognitive donne de bons résultats. Pour en décrire le principe, imaginons un patient hypocondriaque, qui a mal au ventre et se dit que cela pourrait être un cancer de l’intestin. Pour lui, c’est clair: angoisse de mort, émotions négatives, déferlement d’hormones du stress, qui activent son système digestif et amplifient le symptôme. Le voilà pris dans une spirale d’angoisse infernale. C’est très fréquent.
Comment travaille-t-on avec cette personne? Il va falloir se pencher ensemble sur cette pensée irrationnelle selon laquelle le mal de ventre indiquerait une maladie grave. Le thérapeute va alors l’aider, non pas en lui soufflant la réponse, mais en l’amenant à trouver par elle-même ces explications alternatives, plus rationnelles, de manière à déconstruire sa conviction déraisonnable.
Au fil de la séance, le patient peut être amené à énoncer ainsi luimême une dizaine d’autres causes éventuelles. On va lui demander de les coucher par écrit. Le but: aller bien au-delà d’un travail sur les causes possibles de ce symptôme, et entraîner son esprit à produire des à «pensées rassurantes».
Car c’est là la différence entre le sujet anxieux et le non anxieux: chez ce dernier, le cerveau est entraîné à développer de lui-même, de façon automatique, des pensées rassurantes. Celui de l’anxieux l’est beaucoup moins. Telle est donc la mission de la restructuration: aider les réseaux de neurones du sujet à engendrer des pensées rassurantes et des processus de recherche de solutions.
Il ce va ainsi devenir son propre psy; n’est pas une image, c’est le but de la restructuration, car il faut que le cerveau du sujet passe d’un mode rumination à un mode plus rationnel et rassurant.